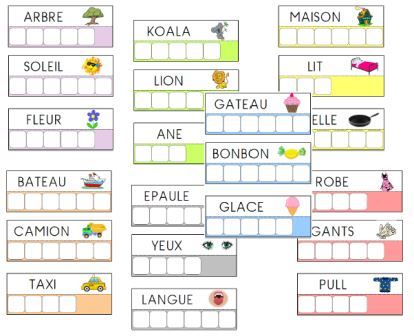Note : Cet article est une reprise de l’intervention de clôture d’Emmanuel Delannoy, qui animait les XIIèmes rencontres de Fos, sur le thème de l’écologie industrielle et territoriale, les 13 et 14 juin 2013. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un compte rendu, mais plutôt d’un retour sur quelques éléments marquants et d’une mise en perspective des échanges qui ont eu lieu pendant ce colloque national. Des actes sont en cours de préparation, nous vous les signalerons lors d’une prochaine édition de cette lettre d’information.
Note : Cet article est une reprise de l’intervention de clôture d’Emmanuel Delannoy, qui animait les XIIèmes rencontres de Fos, sur le thème de l’écologie industrielle et territoriale, les 13 et 14 juin 2013. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un compte rendu, mais plutôt d’un retour sur quelques éléments marquants et d’une mise en perspective des échanges qui ont eu lieu pendant ce colloque national. Des actes sont en cours de préparation, nous vous les signalerons lors d’une prochaine édition de cette lettre d’information.
Ces XIIèmes rencontres de Fos, avec leurs deux jours de débats et de partage d’expérience, ont été riches. Riches de contenu, mais aussi d’imprévus. Elle furent placées sous la pression constante des délais à respecter, et le manque de temps aura été un véritable « fil rouge », un dénominateur commun – heureusement pas le seul – des plénières, ateliers et visites de sites. Ces rencontres de Fos étaient donc bien de leur temps, de cette époque caractérisée par un climat permanent d’urgence, par le sentiment de vivre sous pression et l’obligation qui nous est faite de gérer au mieux la double contrainte des imprévus, auxquels il faut s’adapter, et du cap qu’il faut pourtant absolument maintenir. Une vraie leçon de vie, ces rencontres de Fos !
Cet événement imprévu, le premier jour en fin de matinée, constitue une véritable « irruption » du réel dans nos débats, pourtant déjà peu enclins à l’excès de théorie ou à la langue de bois. Cette arrivée inopinée d’une bonne centaine de syndicalistes, représentant les salariés de l’entreprise KEM One condamnée à la fermeture par son actionnaire principal, mérite qu’on y revienne. Que l’on regarde au-delà du « folklore » syndicaliste – baudriers fluorescents, drapeaux rouges, fumigènes – pour y reconnaître un sentiment de fierté : de ce qu’ils sont, de leur métier et de la façon dont ils l’exercent. Cette fierté, nous en avons tous besoin, elle est constitutive de notre identité. Mais au-delà de ces codes, ce qui nous a été donné à voir, et à ressentir, c’est une réalité poignante. Celle d’une peur de l’avenir et d’une perte de confiance dans la capacité des dirigeants à passer des paroles aux actes. Ce que nous avons vu, c’est l’illustration d’une perte de confiance, hélas plus générale, de la part d’une part importante de la population, vis-à-vis de ceux qui nous représentent, nous emploient, et prennent des décisions qui nous concernent.
Mais il y avait aussi une lueur d’espoir, un signal, même faible, et pourtant encourageant : si les salariés de KEM One se sont donné la peine de venir ce jour-là, dans cet amphithéâtre, c’est qu’ils espéraient y être entendus, et y trouver quelques personnes capables d’écouter et de comprendre leur situation. Même si ce n’est pas vraiment un dialogue qui s’est tenu à cette occasion, cela en est peut être l’amorce.
Les manifestants ne sont pas venus les mains vides, avec leurs seules amertume et rancœur. Ils sont venus avec des propositions concrètes et des attentes précises. Ils sont venus dans l’espoir de trouver des interlocuteurs capables d’entendre leurs craintes et d’écouter leurs propositions. Même si c’était par effraction, nous avons été identifiés comme des interlocuteurs potentiels, et c’est un honneur, mais aussi une responsabilité que nous devons assumer. Impossible désormais de nous dérober : l’écologie industrielle et territoriale, c’est du concret, c’est des femmes et des hommes qui travaillent, des familles qui vivent, et des habitants qui attendent qu’on leur ouvre d’autres perspectives que la désindustrialisation et une lente agonie économique de leurs territoires.
Sans transition, et pour essayer de faire un peu plus léger maintenant, – quoique… – il a beaucoup été question, pendant les débats et les ateliers, de la participation et de la mobilisation des acteurs, quels qu’ils soient, et de l'incitation au changement, nécessaire mais forcément difficile. Comment faire ?
A plusieurs reprises, ont été évoquées l'interdisciplinarité, la nécessité de se faire accompagner dans cette transition par des sociologues et des experts susceptibles de nous aider à identifier les freins culturels ou psychologiques, mais aussi les leviers d’action.
Or, il y a quelques années, une expérience intéressante a été conduite, par des sociologues, dans une petite ville résidentielle des Etats-Unis. La question portait sur la meilleure manière d’inciter les ménages à réduire leur consommation électrique.
Il a donc, pour les besoins de l’expérience, été constitué 3 groupes :
- Au premier, on a dit qu’il fallait baisser la consommation, parce que c'est dans l'intérêt général. Pour le bien commun, le leur et celui des générations futures.
- Au deuxième, on a expliqué qu’il fallait baisser la consommation, sinon on courrait à la catastrophe.
- Au troisième, on a démontré, chiffres à l’appui, qu’ils pourraient faire de substantielles économies.
A votre avis, quel groupe a été le plus efficace pour faire des économies d’énergie ? Le troisième groupe ? Naturellement ! C’est que j’ai répondu moi aussi.
En fait, aucun des trois groupes ne s’est particulièrement distingué. Les résultats étaient à peu près les mêmes, ou en tout cas les écarts n’étaient pas suffisamment significatifs pour être discriminants. Mais il y avait, ce que je ne vous ai pas encore dit, un quatrième groupe. Un groupe à qui on a dit la chose suivante : « 80% des habitants de cette ville font mieux que vous en matière de maîtrise de leur consommation électrique». Et il s’en est suivi que, piqués au vif, d’eux-mêmes, les membres de ce groupe se sont mis à chercher toutes les solutions imaginables pour baisser leur consommation électrique, avec des résultats particulièrement probants.
Même si ça ressemble à un gag, c'est de la sociologie!
Notez qu’à ce titre, nous ne sommes pas très différents d’autres membres du règne animal, pourtant assez éloignés de nous sur l’arbre du vivant. Prenons par exemple le cas d’Alex, le perroquet de la neurochimiste Irene Pepperberg. En étudiant les capacités cognitives des oiseaux, par des expériences sur des perroquets, elle s’est rendu compte que, comme beaucoup d’oiseaux (les perroquets, mais aussi la grande famille des corvidés), Alex était capable d’appréhender de nombreux concepts abstraits, de faire des associations pertinentes, de déduire, et de résoudre des problèmes relativement complexes. Mais pendant longtemps ses expériences ont échoué, à tel point qu’elle a cru un moment que les perroquets étaient tout simplement aussi stupides qu’on le disait. Jusqu’à ce qu’un membre de son équipe ait l’idée, assez saugrenue a priori, de se mettre à coté du perroquet et de faire semblant de chercher lui aussi à résoudre les problèmes qu’on soumettait à Alex. Et c’est alors que, stimulé par la compétition avec le faux cobaye humain, Alex le perroquet relevait le défi avec ardeur, histoire de démontrer qu’il était meilleur que son rival.
Les habitants de cette petite ville qui devaient faire des économies d’énergie ne s’attendaient sans doute pas à être un jour comparés à un perroquet, même s’il porte un prénom bien humain… Mais ne riez pas ! Nous sommes comme ça : une partie de nous- même, plus ou moins refoulée mais toujours présente, est animée par un esprit d’émulation, par le besoin de se distinguer des autres. Le sociologue Thorstein Veblen l’avait bien compris, avec sa théorie des rivalités ostentatoires. Les spécialistes du marketing et de la publicité eux aussi, d’ailleurs. Eux qui, en nous incitant par d’habiles messages, tantôt quasi subliminaux, tantôt parfaitement explicites, à nous distinguer du lot commun par notre consommation. Voici achevée la démonstration que nous sommes aussi faciles à manipuler qu’Alex, le perroquet.
Puisque nous sommes sur le terrain – vaste par définition – de la pluridisciplinarité, poursuivons avec l’anthropologie. Qui sommes-nous, vraiment ? Des Cro magnons : les mêmes, exactement, que ceux nous ont précédé il y a 10.000 ans, soit à peine l’intervalle nécessaire pour 400 générations ? A l’époque, nous étions tous des chasseurs cueilleurs, nomades, vivant jour après jour en prise directe avec la nature, comme le sont d’ailleurs encore une partie de nos contemporains. Et pourtant, si nous, nous n’avons que peu, voire pas du tout, changé, c’est peu dire que le monde dans lequel nous vivons a, lui, considérablement évolué. A tel point qu’Anne et David Premack ont pu poser avec pertinence la question de savoir si nous étions assez intelligents pour appréhender la complexité du monde que nous avions nous même créé. Vous relevez le défi ? Il vaudrait mieux…
Mais poursuivons avec cette question : qui sommes-nous vraiment ? Quelles sont nos aspirations dans la vie ? De quoi avons nous besoin ? Tim Jackson, dans son rapport « prosperity without growth », propose la grille d’analyse suivante : imaginez une cartographie de vos aspirations, sous la forme d’un écran radar. Sur l’axe vertical, au sommet, vous avez « Nouveauté », ce qui correspond à notre besoin réel de faire de nouvelles découvertes, de ressentir de nouvelles sensations, d’aller au-delà de ce que nous connaissons déjà. En bas de l’écran, vous avez « Héritage », ce qui correspond au besoin, tout aussi réel, de nous ancrer dans un patrimoine, une culture, des traditions, héritées d’un passé plus ou moins lointain. Les deux pôles ne s’opposent pas, ils s’équilibrent. Sur l’axe horizontal, à droite, vous avez « moi » : votre besoin, légitime et incontestable, de vous réaliser, de vous forger une personnalité unique, une identité propre. Sur le même axe, à gauche, vous avez « les autres ». Ce qui correspond à un besoin, tout aussi réel et profondément ancré dans notre nature humaine, de nous intéresser, de la manière la plus spontanée et altruiste qui soit, aux autres, et de leur venir en aide.
Essayez maintenant de vous souvenir des affiches que vous avez vues ce matin dans la rue, des publicités que vous avez entendues à la radio, ou vues à la télévision récemment. Il n’y a rien qui vous étonne ? Presque toutes font appel à un seul quart du cadran, celui faisant référence à votre attirance pour la nouveauté et à votre besoin de vous démarquer. D’où une incitation à consommer toujours plus, et une frustration croissante liée à une usure rapide du sentiment de satisfaction que vous aura procuré cette consommation effrénée, et l’oubli d’un bon trois quart de vos aspirations réelles, de celles qui font une vie épanouie, riche de relations, conviviale. Étonnant, non ? Notre économie ferait-elle l’impasse sur les trois quarts du quadrant ? Voilà une belle invitation à favoriser l’émergence de modèles économiques innovants, ou, pour le dire autrement, à créer de la valeur en prenant appui sur d’autres valeurs.
Pour poursuivre ce tour d’horizon de la pluridisciplinarité, à laquelle ces rencontres de Fos nous ont largement invités, convoquons maintenant dans l’ordre la systémique, la thermodynamique, l’écologie, la biologie de l’évolution, et enfin, et bien-sûr, l’économie.
Les systèmes complexes répondent à un principe général qui veut que le tout est plus que la somme des parties. C’est vrai des atomes, des molécules, des cellules, des organismes vivants et bien-sûr des communautés d’êtres vivants organisées en écosystèmes. Ce principe, c’est l’émergence. La conséquence de ce principe, c’est qu’il est impossible de comprendre le fonctionnement du tout en isolant chacun de ses constituants. Seule une vision globale, systémique, centrée autant, sinon plus, sur les interactions que sur les entités, peut nous aider à comprendre ce qui se passe.
La systémique, c’est aussi la distinction entre des systèmes ouverts qui échangent des flux d’information, d’énergie et de matière avec l’extérieur, des systèmes fermés, qui n’échangent que de l’énergie et/ou de l’information avec l’extérieur, ou encore des systèmes clos, qui n’ont aucun échange avec l’extérieur. Si nos villes, nos territoires, nos zones d’activités sont à leurs échelles des systèmes ouverts, notre planète, la Terre, doit être considérée comme un système fermé. Et c’est bien là que réside le socle de base du cahier des charges pour un développement soutenable : s’épanouir durablement, dans un système fermé comme la biosphère, suppose de s’appuyer sur des énergies réellement renouvelables sur le long terme (le rayonnement solaire et ses dérivés, la géothermie, …), et de ne pas produire de déchets, notion qui est d’ailleurs étrangère au fonctionnement du monde vivant qui recycle ses constituants depuis 3,8 milliards d’années, et qui repose, pour la synthèse des molécules complexes dont il a besoin, sur la seule énergie du soleil.
Puisque nous sommes sur le terrain de l’énergie, invoquons brièvement la thermodynamique pour rappeler son deuxième principe, dit aussi principe de Carnot : s’il y a bien un domaine où la flèche du temps s’applique, à quelque échelle de ce soit et de manière irréversible, c’est bien pour ce qui concerne la dégradation de l’énergie. Toute énergie dissipée, sous forme de travail et de chaleur, l’est irréversiblement. Ce simple constat devrait nous inciter à faire reposer notre développement économique sur le flux d’énergie constant qui nous arrive du soleil (du moins pour les quatre milliards d’années à venir), plutôt que sur les stocks finis , et voués à une dégradation irréversible, d’hydrocarbures fossiles que nous ont légués les écosystèmes des âges farouches du carbonifère. Comment passer d’une économie du stock à une économie du flux ? C’est la feuille de route de l’économie circulaire.
Au tour de l'écologie maintenant. Comment la définir de manière plus simple ? La science des relations entre les êtres vivants ? Ce qui inclut, de fait, leurs diverses activités. Pour ce qui nous concerne, cela inclut l’agriculture, l’industrie, les services, les villes et leur fonctionnement. Richard Dawkins parle de « phénotypes étendus », pour désigner les termitières ou les structures complexes comme des nids, élaborées par des organismes vivants ; il entend par là, la façon dont leur génome s’exprime et se matérialise autrement que par leurs caractéristiques physiques corporelles. Pour ce qui nous concerne, nos villes, bâtiments, infrastructures et autres édifices sont bien le produit de notre activité, et peuvent être considérés, d’une certaine manière, comme notre phénotype étendu. En cela, l’expression « écologie industrielle » est, contrairement à ce qu’on entend parfois, tout sauf un oxymore : elle ne fait qu’inclure l’humain, et tout ce qui s’y rattache, dans le champ de l’écologie scientifique. Mais l’écologie, en mettant en évidence des interactions, des liens d’interdépendance entre nos activités et le tissu vivant des territoires, à travers cette notion encore récente et parfois mal interprétée de « services rendus par les écosystèmes », nous permet de comprendre que notre économie, ne peut se développer « hors sol », déconnectée du vivant. En prenant conscience de cette dépendance étroite vis-à-vis du système vivant planétaire que nous connaissons encore mal, nous pouvons envisager l’idée d’une « solidarité écologique », au sein des territoires et entre eux. Ce concept encore émergeant permet de faire la synthèse – et non un quelconque arbitrage fallacieux – entre enjeux sociaux et écologiques.
Poursuivons avec la biologie de l’évolution : ce que nous apprennent les paléontologues, c’est que la vie sur terre a une histoire, qu’elle se transforme, qu’elle modifie son environnement et s’adapte en retour aux modifications de son environnement. Entre les organismes vivants, c’est une dynamique permanente d’ajustements, de variations, de coopération, de symbioses, de sélection, en un mot de coévolution. Et cette histoire, cette très longue histoire, ponctuée d’épisodes de changements radicaux, parfois catastrophiques, laisse une large part au hasard, aux contingences, à l’incertitude. Face à cette incertitude, la meilleure stratégie d’adaptation, la clé de la résilience, c’est la diversité. Comme le rappelait Aldo Léopold, la règle numéro 1 du bricolage, c’est de garder toutes les pièces. Préserver la biodiversité aujourd’hui, c’est garder toutes les pièces. On ne sait jamais…
A chacune des grandes crises qui ont jalonné l’histoire du vivant sur terre, certains bricolages ont marché mieux que d’autres. Certaines adaptations se sont perpétuées, d’autres pas. Mais les « bricolages » qui ont souvent le mieux marché sont ceux qui reposaient sur des structures existantes, dont les caractéristiques ont pu être reprises pour en faire autre chose, pour des fonctions radicalement différentes, dans un contexte auparavant inédit. Il en est ainsi des plumes de certains dinosaures qui les aidaient à réguler leur température corporelle et sont devenues chez les oiseaux des appendices parfaitement adaptés au vol. Ou encore des poumons primitifs de certains poissons dipneustes devenus les vessies natatoires, organes indispensables aux poissons modernes, leur permettant de se repérer dans la profondeur du monde liquide dans lequel ils se meuvent. Ce phénomène, que les paléontologues appellent « exaptation », plaide pour une nouvelle approche de l’innovation, face aux changements globaux et rapides qui caractérisent notre époque. L’exaptation, c’est un accélérateur d’innovation, c’est une manière de repenser les usages, l’organisation des territoires, la valorisation des compétences. C’est une manière de regarder autrement nos infrastructures en nous demandant comment les utiliser autrement, dans un contexte radicalement différent.
Mettre en œuvre une économie circulaire et de fonctionnalité, sans avoir à tout jeter, mais en essayant au contraire de capitaliser au maximum sur ce qui existe aujourd’hui, c’est de l’exaptation.
Terminons ce tour d’horizon des disciplines par l'économie. Ah, évidemment, l’économie ! Avec ce qu’elle peut avoir de désagréable par ses rappels insistants aux réalités. On aimerait bien le faire, mais on n’a pas les moyens ! Vraiment ? Mais en économie aussi, on peut innover ! L’économie, c’est aussi, et c’est naturel, rechercher des opportunités, des fruits mûrs à cueillir, des « quick wins », comme disent nos amis belges… Et l’économie n’est pas une discipline statique, fossilisée dans un corpus de pensées hérité du XIXème siècle ! Sans jeter aux oubliettes Malthus, Adam Smith ou Jean-Baptiste Say, hissons-nous sur leurs épaules pour voir un peu plus loin. La gestion des biens communs, si urgente aujourd’hui, c’est aussi de l’économie. On pensait jusqu’à il y a peu que, pour échapper à la tragédie des biens communs telle qu’elle avait été théorisée par Garret Hardin, il n’existait que deux possibilités : réguler l’usage, de façon autoritaire et renoncer aux vertus de l’initiative et de l’entreprenariat ou privatiser et renoncer à l’idée même de bien commun. Cette vision occidentale, réductrice, a été récemment battue en brèche par Elinor Orstrom, prix Nobel d’économie 2009, qui a démontré que les biens communaux pouvaient être gérés efficacement et durablement, de manière participative et collaborative, en sollicitant l’initiative et le partage d’information, en misant sur une approche contractuelle.
De même que l’évolution, contrairement à ce qu’une lecture tronquée de Darwin nous a longtemps laissé croire, n’est pas qu’une affaire de lutte pour la survie du plus apte mais fait appel à la coopération, l’économie n’est pas qu’une affaire de compétition, de conquête et de domination. Le partage, la coopération, la recherche de synergies gagnant / gagnant, c’est aussi de l’économie !
Cette tentative de conclusion provisoire est surtout une manière personnelle de vous inviter à intégrer les différents et nombreux paramètres qui feront le succès de vos initiatives sur le terrain. L’approche verticale, en silo, de disciplines cloisonnées est désormais obsolète. Faire tomber les cloisons de la connaissance, miser sur une l’interdisciplinarité, mobiliser les outils de l’intelligence collective et la modélisation participative sont les meilleures garanties du succès de vos projets.
Enfin, vous l’aurez compris, et ça nous a été rappelé de manière poignante lors de ces rencontres, l’écologie industrielle, ce n’est pas qu’une affaire de flux, de boucles de matières premières, d’efficacité énergétique, même si ce sont des éléments d’entrée importants. L’écologie industrielle, c’est avant tout une histoire de territoire, de projets de développement, de solidarité, d’interdépendances, d’emplois. L’écologie industrielle et territoriale, c’est une manière de repenser la prospérité, au sens premier du mot, qui signifie avoir confiance en l’avenir. L’écologie industrielle, c’est une manière de remettre l’Homme, avec un grand H, au cœur de l’économie. C’est ce défi là que nous avons mis en évidence pendant ces deux jours de colloque, et c’est ce défi que nous aurons désormais à cœur de relever.
Rendez-vous l’année prochaine pour vos retours d’expérience sur la mise en œuvre de ces réflexions.